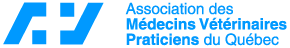mardi, 28 novembre 2017
La disparition de la tourte voyageuse provoquée par son ADN
Par Ricardo Codina
La tourte voyageuse (communément appelé pigeon voyageur) qui comptait 3 à 5 milliards de spécimens en Amérique du Nord à l'arrivée des Européens sur le continent, a disparu en quelques dizaines d'années seulement. On a longtemps pensé que la chasse intensive des humains était la cause de l'extinction pure et simple de cette espèce. Il semblerait, nous apprenait Radio-Canada cette semaine, qu'une faible diversité génétique aurait précipité cette disparition.
La tourte voyageuse était un volatile ressemblant à un croisement entre la tourterelle et le pigeon de nos villes. C'est l'oiseau qui était, avant l'arrivée des Européens, le vertébré le plus abondant en Amérique et possiblement dans le monde. En effet, cet oiseau se regroupait en voiliers gigantesques rendant l'agriculture extrêmement difficile. C'est la raison pour laquelle la tourte se retrouvait au bout du fusil des chasseurs et au menu des familles au début de la colonisation de l'Amérique. Il faut dire que cette volaille était faille à attraper. Partir chasser cet oiseau le matin, il n'était pas rare d'en rapporter une centaine d'individus au coucher du soleil.
La chasse n'est pourtant pas la cause directe de son extinction. La tourte, en effet, était incapable de survivre en plus petits groupes. Seuls les immenses voiliers lui permettaient de s'en tirer. La chasse ayant décimé ces grands groupes trop rapidement pour qu'il s'adapte, l'oiseau fut incapable de survivre en plus petits regroupements jusqu'à la dernière tourte voyageuse, une femelle nommée Martha, qui est décédée au zoo de Cincinnati en Ohio le 1 septembre 1914. C'est ce que croit le professeur Beth Shapiro de l'Université de la Californie à Santa Cruz, rapporte Radio-Canada.
Sa collègue Gemma Murray et son groupe de recherche ont fait l'analyse de la diversité génétique de tourtes empaillées que l'on retrouve dans les musées américains. Les résultats ont été publiés dans la revue Science et ils illustrent une faible diversité génétique. La stabilité des grands voiliers durant des milliers d'années a permis d'entraîner une perte énorme de diversité génétique. Ils étaient adaptés à un environnement très stables de grandes populations. L'arrivée des colons et la chasse a provoqué un changement très rapide et leur génétique n'était pas adaptée pour faire face à la chasse et à une réduction de population. Un point de bascule a été atteint provoquant la disparition de l'espèce. Gemma Murray déclare à cet effet : «Nos résultats sont conformes à l’idée que l’adaptation du pigeon voyageur à de grandes populations a pu devenir un handicap lorsque le nombre de spécimens s’est brusquement réduit. Ils correspondent à cette hypothèse et nous n'avons trouvé aucune preuve que la population était instable avant que les humains (Européens) ne commencent à les chasser».
Avec ces résultats il devient donc, selon les auteurs, possible de mieux connaître le rôle que la génétique peut jouer dans une extinction animale et, espérons-le, aider aux efforts qu'il faut faire pour sauver les espèces qui restent dont beaucoup, aujourd'hui, sont menacées.
La tourte voyageuse (communément appelé pigeon voyageur) qui comptait 3 à 5 milliards de spécimens en Amérique du Nord à l'arrivée des Européens sur le continent, a disparu en quelques dizaines d'années seulement. On a longtemps pensé que la chasse intensive des humains était la cause de l'extinction pure et simple de cette espèce. Il semblerait, nous apprenait Radio-Canada cette semaine, qu'une faible diversité génétique aurait précipité cette disparition.
La tourte voyageuse était un volatile ressemblant à un croisement entre la tourterelle et le pigeon de nos villes. C'est l'oiseau qui était, avant l'arrivée des Européens, le vertébré le plus abondant en Amérique et possiblement dans le monde. En effet, cet oiseau se regroupait en voiliers gigantesques rendant l'agriculture extrêmement difficile. C'est la raison pour laquelle la tourte se retrouvait au bout du fusil des chasseurs et au menu des familles au début de la colonisation de l'Amérique. Il faut dire que cette volaille était faille à attraper. Partir chasser cet oiseau le matin, il n'était pas rare d'en rapporter une centaine d'individus au coucher du soleil.
La chasse n'est pourtant pas la cause directe de son extinction. La tourte, en effet, était incapable de survivre en plus petits groupes. Seuls les immenses voiliers lui permettaient de s'en tirer. La chasse ayant décimé ces grands groupes trop rapidement pour qu'il s'adapte, l'oiseau fut incapable de survivre en plus petits regroupements jusqu'à la dernière tourte voyageuse, une femelle nommée Martha, qui est décédée au zoo de Cincinnati en Ohio le 1 septembre 1914. C'est ce que croit le professeur Beth Shapiro de l'Université de la Californie à Santa Cruz, rapporte Radio-Canada.
Sa collègue Gemma Murray et son groupe de recherche ont fait l'analyse de la diversité génétique de tourtes empaillées que l'on retrouve dans les musées américains. Les résultats ont été publiés dans la revue Science et ils illustrent une faible diversité génétique. La stabilité des grands voiliers durant des milliers d'années a permis d'entraîner une perte énorme de diversité génétique. Ils étaient adaptés à un environnement très stables de grandes populations. L'arrivée des colons et la chasse a provoqué un changement très rapide et leur génétique n'était pas adaptée pour faire face à la chasse et à une réduction de population. Un point de bascule a été atteint provoquant la disparition de l'espèce. Gemma Murray déclare à cet effet : «Nos résultats sont conformes à l’idée que l’adaptation du pigeon voyageur à de grandes populations a pu devenir un handicap lorsque le nombre de spécimens s’est brusquement réduit. Ils correspondent à cette hypothèse et nous n'avons trouvé aucune preuve que la population était instable avant que les humains (Européens) ne commencent à les chasser».
Avec ces résultats il devient donc, selon les auteurs, possible de mieux connaître le rôle que la génétique peut jouer dans une extinction animale et, espérons-le, aider aux efforts qu'il faut faire pour sauver les espèces qui restent dont beaucoup, aujourd'hui, sont menacées.